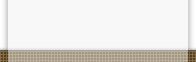| quinta-feira, março 10, 2005 |
| Um retrato de Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski |
A propóstito do post sobre o livro de Steiner, reproduzo um texto de Jean Montenot, da Lire deste mês.
"La renommée, pour Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, est arrivée sur le tard. Le grand écrivain russe a bâti en une dizaine d'années son œuvre magistrale. Une œuvre habitée de personnages tourmentés cherchant les voies de la rédemption.
Nous sommes en mars 1865. Dostoïevski a 43 ans. Il fait le point sur sa vie: «Et voici que je restai seul et que la peur s'empara tout bonnement de moi. D'un coup, toute ma vie se trouvait brisée en deux. Dans la moitié que j'avais derrière moi, il y avait tout ce pour quoi je vivais, dans l'autre qui m'était encore inconnue, tout le nouveau, l'étranger, et pas un cœur qui, pour moi pourrait remplacer ces deux-là. Créer de nouveaux liens, inventer une vie nouvelle! La simple idée m'en donne la nausée1.» Et de fait, l'avenir est bien sombre pour Fiodor - c'est-à-dire Théodore - Mikhaïlovitch Dostoïevski. Il vient de perdre, l'année précédente, coup sur coup, sa première épouse, Maria Dimitrievna, et Mikhaïl, son frère aîné et confident depuis toujours. A la détresse morale liée à ces deuils et, peut-être aussi, consécutive à l'échec de sa relation extraconjugale avec Apollinaria Souslova, s'ajoutent des difficultés financières. Maria, épousée en 1857, veuve d'un petit fonctionnaire alcoolique, lui laisse un beau-fils, Pavel. Et la décision courageuse de prendre à sa charge la famille de son frère défunt aggrave les choses. «Seul un hasard2 peut me sauver. De toute ma réserve de forces et d'énergie, il ne me reste dans le cœur qu'angoisse et trouble, quelque chose qui se rapproche du désespoir.3» Et pourtant, cet homme en plein désarroi est bien celui qui vient de faire paraître (mars 1864) un petit texte décisif: la première partie des Ecrits du sous-sol dont le héros (anonyme) rejette les thèses progressistes à la mode selon lesquelles l'instruction et la raison peuvent conduire l'homme au bonheur. Il revendique, au contraire, le droit de l'individu à l'opacité, à la complexité, aux contradictions, le droit de rester dans son trou et de refuser les utopies dangereuses du «palais de cristal», les mirages de l'utilitarisme et de l'égoïsme rationnel.
«Une vitalité de chat...» Cet homme brisé, qui se définissait en 1854 comme un «enfant de l'incroyance et du doute» dont la «soif de croire» est renforcée d'autant «qu'il y a en lui d'arguments contraires», va écrire «à la baguette» en moins d'une décennie l'essentiel des chefs-d'œuvre qui lui valent d'être aujourd'hui considéré comme le géant des lettres russes. Crime et châtiment (1866), le plus célèbre, sans doute le mieux construit, inaugure le genre du roman policier psychologique et métaphysique. Suit Le joueur (1866) qui est, entre autres, une forte étude psychologique des «accros» de la passion du jeu. L'idiot (1868-1869) relate les mésaventures du prince Mychkine, un être bon, indulgent et humble, mais aussi une figure christique, un illuminé inadapté à ce monde où règnent la cupidité et les passions. Au bout du compte, le héros cristallise autour de lui toutes les rancœurs, les ambitions, les haines, l'amour et entraîne la ruine de tous ceux qu'il côtoie. Dans la foulée, L'éternel mari (1870), bien davantage qu'une variation sur le thème du mari trompé, et Les démons (aussi traduits sous le titre Les possédés, 1871), critique en règle des milieux progressistes et libéraux que Dostoïevski avait fréquentés, achèvent de montrer la vitalité de cet homme abattu. Tous ces romans ont en commun de mettre en scène des êtres au bord du gouffre en quête d'une rédemption et d'une renaissance. Plus tard viendront les articles du Journal d'un écrivain (à partir de 1873) où il fait œuvre de journaliste et de polémiste sur le ton nouveau du «dialogue ouvert avec le lecteur4» et où il se montre défenseur ardent, passionné et souvent excessif des tendances slavophiles de la culture russe. L'adolescent (1875) et Les frères Karamazov (1880) parachèvent une production romanesque que la mort interrompt en janvier 1881. Et le plus singulier est que, du fond de son désespoir, Dostoïevski pressent tout cela: après avoir fait le constat lucide de sa situation du printemps 1865, il confesse dans cette même lettre à Wrangel, jeune magistrat devenu son ami au sortir du bagne: «Or, il me semble seulement que je m'apprête à vivre. Risible, n'est-ce pas? Une vitalité de chat5...»
«L'homme est un mystère. Il faut l'élucider.»
Celui qui, en 1865, «s'apprête à vivre» a pourtant déjà une vie bien remplie. Et même plusieurs! Une vie en montagnes russes, où alternent hauts et bas comme gains et pertes à la roulette. Deuxième fils du docteur Dostoïevski, un homme rude depuis peu anobli par le tsar, Fiodor Mikhaïlovitch a voué assez jeune sa vie à la littérature, d'abord comme lecteur passionné, ensuite comme écrivain. Si les morts successives, en 1837, de leur mère phtisique dont les grossesses répétées avaient altéré la santé, et de Pouchkine, leur héros, le maître incontesté de la littérature et de la langue russes modernes, affectent les deux aînés de la famille, Mikaïl et Fiodor, ils ne s'élancent pas moins avec enthousiasme vers une nouvelle vie. «Nous rêvions éperdument d'on ne sait quoi, de tout ce qui est "beau et grand"», écrit bien plus tard Dostoïevski en évoquant cette période de sa jeunesse où Mikaïl écrit chaque jour des poésies et où Fiodor ne cesse de «composer en esprit» un roman vénitien. Entré à l'école militaire du Génie, Fiodor n'a pas la vocation pour une carrière que son père, dans un premier temps, et, par la suite, son tuteur et beau-frère Karépine, auraient voulu lui voir embrasser. C'est peu après la mort de son père (1839), officiellement des suites d'une crise d'apoplexie - en fait, il aurait été victime d'une vengeance de ses serfs - que, d'après certains exégètes, Fiodor aurait eu une première crise convulsive, prélude aux crises d'épilepsie ultérieures. Quoi qu'il en soit, l'ambition du jeune homme - plus encore que celle de l'écrivain - s'affirme avec force dans une lettre à son frère: «Je n'ai qu'une visée: être libre. J'y sacrifie tout. Mais souvent, souvent, je pense à ce que m'apportera la liberté... Que ferai-je, seul parmi la foule inconnue? [...] Je suis sûr de moi. L'homme est un mystère. Il faut l'élucider et si tu passes à cela ta vie entière, ne dis pas que tu as perdu ton temps; je m'occupe de ce mystère car je veux être un homme.6»
«Un nouveau Gogol est né...»
La liberté prend d'abord la forme d'une relative licence. A Saint-Pétersbourg, Fiodor fréquente concerts, théâtres, ballets, dilapide l'argent que lui envoie son tuteur. Il s'enthousiasme pour Balzac, auteur alors en vogue, dont il traduit très librement Eugénie Grandet avec l'espoir d'en tirer quelques subsides. Comme il le fera plus tard à la roulette, le jeune Dostoïevski brûle ses vaisseaux. Il renonce à ses droits d'héritier contre une soulte et prend, dès 1844, sa retraite de lieutenant pour «convenances personnelles». Il commence alors Les pauvres gens, «ma première nouvelle sans avoir jamais rien écrit jusqu'alors7». Il s'agit d'un roman épistolaire évoquant l'existence des pauvres gens à Saint-Pétersbourg. Dostoïevski ne se contente pas d'y brosser un «tableau» de Saint-Pétersbourg - les descriptions en règle y sont d'ailleurs fort rares. Son originalité, qui le distingue du génie de l'époque, Gogol, tient à ce qu'il porte le regard à l'intérieur de ses personnages. Il semble même écrire pour eux et se demande comment chacun voit le monde. Le poète Nekrassov est transporté d'admiration lorsque, en mai 1845, il lit le manuscrit. Il voit en Dostoïevski la nouvelle étoile montante: «Un nouveau Gogol nous est né...», déclare-t-il au célèbre (et terrible) critique Bélinsky. Ce dernier se méfie de l'enthousiasme de Nekrassov pour cet écrivain de 22 ans: «Les Gogol, chez vous, ça pousse comme des champignons!» Finalement, Bélinsky aussi est conquis. Dostoïevski sort de chez lui enflammé: «Est-il possible que je sois si grand? [...] Ce fut la minute la plus exaltante de ma vie.8» Il multiplie nouvelles et récits, accueillis avec d'autant plus d'indifférence que le succès initial a grisé un Dostoïevski plus maladroit dans les salons que prétentieux. De cette première salve, on retient Le double ou les aventures de monsieur Goliadkine. Nabokov, pourtant peu complaisant pour l'écrivain et l'homme Dostoïevski, le tient même pour son meilleur livre. Le roman relate les invincibles angoisses d'un homme aux prises avec son double, Goliadkine junior, sosie qui occupe le même poste que lui dans l'administration et empoisonne son existence au point de la rendre impossible. Goliadkine finira à l'asile. S'inaugure avec ce roman, sous une forme tragi-comique et métaphorique, une constante des personnages dostoïevskiens ultérieurs: la dualité interne et le conflit avec soi-même qui en procède. Le moi des personnages se dédouble; ils cherchent, dans une sorte de dialogue avec cet autre qui est en eux, une issue pour se réconcilier avec eux-mêmes.
Du rêve du phalanstère à la réalité du bagne
Si l'année 1848 est pour l'Europe celle du «printemps des peuples», pour la Sainte Russie du tsar Nicolas Ier, c'est plutôt l'hiver. Répression tous azimuts! Le malheur veut que le jeune Dostoïevski, qui n'est pas encore redescendu de son nuage, fréquente alors les milieux libéraux. Il fait partie du cercle Pétrachevski9, où se rassemblent des intellectuels, jeunes et diplômés, qui ont le grand tort de lire Fourier, Saint-Simon et de commenter diverses théories socialistes, bref de diffuser des idées subversives. Tout cela finit à la forteresse Pierre-et-Paul où sont enfermés les membres du cercle, dont Dostoïevski. Suit une condamnation à mort! Le 22 décembre 1849: on prend plaisir à n'annoncer qu'au dernier moment aux condamnés et alors qu'ils sont devant le peloton d'exécution, pour certains d'entre eux déjà ligotés au poteau, que leur peine a été commuée en déportation au bagne10. Fini la liberté extérieure donc! Il va falloir expier. Et pourtant, Dostoïevski ne renonce pas: «Frère! Je n'ai pas perdu espoir ni courage. La vie est partout la vie, la vie est en nous, non dans le monde extérieur. [...] Etre homme parmi les hommes et le rester à jamais, dans tous les malheurs possibles ne pas perdre espoir et courage, voilà où est la vie, où est son but. [...] Cette idée m'est rentrée dans la chair et dans le sang.11» C'est au bagne que le jeune rêveur rencontre la Russie profonde, celle du petit peuple, des malfrats et des prisonniers politiques, loin de Saint-Pétersbourg, la ville corruptrice et occidentaliste. Sous la «rude écorce des bagnards», il se prend d'un amour compassionnel pour cette humanité enracinée dans la terre russe. Il y trouve une foi nouvelle et amorce une conversion au Christ qui est aussi un retournement idéologique. Il ne se révoltera plus, car il est désormais persuadé que la liberté sans limites est une impasse. Convaincu que l'homme est affecté par le mal de l'intérieur et qu'on ne saurait l'amender de l'extérieur par quelque promesse que ce soit, Dostoïevski croit en la possibilité de sa rédemption intérieure par la foi en Christ.
Dans la «maison des morts», avant Soljénitsyne
Faut-il pour autant suivre Dostoïevski lorsqu'il évoque, notamment dans le Journal d'un écrivain, la valeur rédemptrice du bagne? Qu'il ait accepté la sanction avec résignation n'est pas douteux. Il revient de loin. Le condamné à mort est, désormais, une ombre dans la «maison des morts». Au fin fond de la réclusion sibérienne, pendant quatre ans (1850-1854), il ne peut guère lire que les Evangiles, seul ouvrage autorisé, et s'il fait provision de toute une galerie de portraits et de caractères qui passeront dans les écrits ultérieurs, il n'en affirme pas moins à son frère: «Quant à ces quatre années, je les tiens pour un temps où je fus enterré vivant, enfermé dans un cercueil. [...] Ce fut une souffrance indicible, interminable, car chaque heure, chaque minute pesait sur mon âme comme une pierre.12» Prisonnier politique, noble et cultivé, il aurait vécu au milieu de droits communs dont on peut présumer qu'ils ne l'ont jamais considéré comme l'un des leurs. On peut douter que sa rencontre avec le peuple russe fût ce «contact direct» et cette «fusion fraternelle avec lui au sein d'un malheur commun» qu'il s'imagine avoir vécu. La rencontre fut plus spirituelle que réelle, et elle ne date pas forcément du séjour à la maison de force. Le discours de l'écrivain slavophile militant des années 1870 ne concorde pas avec ce qui ressort des impressions d'Alexandre Petrovitch, le noble censé avoir tué sa femme, personnage principal et porte-parole de l'auteur dans les Souvenirs de la maison des morts (1862). Ce roman est le premier jalon d'une série d'œuvres, voire d'un genre littéraire, sur la vie au bagne sibérien. Au siècle suivant, Une journée d'Ivan Denissovitch d'Alexandre Soljénitsyne ou les Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov en sont des témoignages de premier ordre. Personne ne contestera qu'il y ait eu une évolution idéologique chez Dostoïevski, mais qu'elle soit l'effet direct d'un séjour rédempteur au bagne relève sans doute de la légende, même si l'auteur, fût-ce avec sincérité, a lui-même tenté de l'accréditer. L'expérience sibérienne a, en tout cas, fait de Dostoïevski un homme qui ne pouvait plus se payer de mots: sa rupture avec les idéaux modernistes de sa jeunesse est définitive. Alors que la Russie abolit le servage (1861) et s'engage dans la voie d'une modernisation relative, Dostoïevski se met à écrire en contre-plongée depuis ce sous-sol où la «conscience du souriceau humain» s'obstine d'instinct à fuir tout bonheur clé en main, transparent et obligatoire, offert par les promoteurs du «palais de cristal».
La parabole du Grand Inquisiteur
Bien qu'il s'avoue «faiblard en philosophie13», Dostoïevski est aussi un penseur. Certains y ont trouvé argument pour contester son talent romanesque: ses personnages se laisseraient trop aller à des digressions philosophiques, politiques ou spirituelles et gâteraient ses romans en en brisant l'intrigue. C'est une erreur de perspective, ne serait-ce que parce que d'autres auteurs du XIXe siècle en font autant - que l'on songe à Victor Hugo. Le grand critique soviétique Mikhaïl Bakhtine a forgé pour Dostoïevski la catégorie de «roman polyphonique14». En un sens, la «polyphonie» participe de fait à la dissimulation de la pensée de l'auteur. Il est à la fois «présent partout et visible nulle part». Mutatis mutandis, cette omniprésence et cette absence de l'auteur ne sont pas sans rappeler la position de Platon relativement aux personnages de ses Dialogues. C'est pourquoi la tentation demeure forte d'attribuer à Dostoïevski la paternité de telle réflexion de Raskolnikov, du prince Mychkine, voire en négatif d'Ivan Karamazov ou de Stavroguine. Sans prétendre dégager la signification de ce chapitre des Frères Karamazov où Dostoïevski évoque sublimement la légende du Grand Inquisiteur, rappelons la trame de cette parabole, de cette «fantaisie absurde» selon les termes d'Ivan Karamazov lorsqu'il se propose d'en faire le récit à son frère Aliocha. Le Christ, revenu sous son apparence terrestre dans la Séville du XVe siècle en pleine Inquisition, est arrêté sur ordre du Grand Inquisiteur, un vieillard, incarnation du Mal métaphysique et des dérives de l'Eglise de Rome. Le Grand Inquisiteur rend visite au Christ dans sa prison et oppose à sa rédemption un programme de salut de l'humanité qui coïncide avec les conseils donnés au Christ par Satan dans le désert. Ce programme ne s'appuie pas sur la dignité de l'homme et n'exige pas le renoncement à toutes les grandeurs d'établissement, il se propose au contraire d'agir «par le biais du miracle, du mystère et de l'autorité». Il s'agit d'infantiliser l'homme, de le déresponsabiliser, de lui faire perdre le sens du tragique de son existence et, au fond, de la vie. Le Christ répond à ce discours par un baiser: «L'homme est trop vaste, je le rétrécirai.» A cette parole des Frères Karamazov, Dostoïevski a répondu par une formidable galerie d'êtres en lutte contre leur propre rétrécissement que sont presque tous les personnages importants de ses romans, les bons comme les mauvais. Une galerie où le grotesque côtoie le tragique, où les limites du mal et du bien sont repoussées comme jamais. Nul mieux que Dostoïevski - en Russie, du moins - ne s'est aventuré aussi loin sous ces horizons-là.
1. F. M. Dostoïevski, Correspondance, tome II (trad. A. Coldefy-Faucart), éditions Bartillat, p. 86.
2. Le hasard, à bien des égards, prendra la forme d'Anna Grigorievna Snitkine, une sténographe qu'il épouse en 1867 et qui brillera par son abnégation.
3. Ibid. p. 90
4. Cf. Gustave Aucouturier, introduction au Journal d'un écrivain, La Pléiade, 1972, p. IX.
5. Ibid. p. 90
6. Lettre à son frère (16 août 1839). «J'ai versé bien des larmes sur la fin de notre père» est la seule allusion conservée de Dostoïevski à la mort soudaine de son père, cf. F. M. Dostoïevski, Correspondance, tome I, éd. Bartillat, p. 182.
7. Le journal d'un écrivain, janvier 1877 (trad. G. Aucouturier), La Pléiade, p. XX.
8. Ibid. p. 876.
9. Dostoïevski qualifie le groupe «d'association criminelle». Le journal d'un écrivain, janvier 1877, p. 865.
10. On en trouve le récit détaillé par Dostoïevski lui-même dans la lettre à son frère du 22 décembre 1849. F. M. Dostoïevski, Correspondance, tome I, p. 321.
11. F. M. Dostoïevski, Correspondance, tome I, p. 321.
12. Ibid. p. 321.
13. Lettre du 28 mai 1870 à Strakhov. Dostoïevski complète cet aveu: «...mais pas en ce qui concerne mon amour pour elle, sur le plan de l'amour, je suis fort». Correspondance, tome II, p. 582.
14. Mikhïal Bakthtine, La poétique de Dostoïevski, L'Age d'homme, 1970.
© Lire e Jean Montenot |
| posted by George Cassiel @ 12:00 a.m. |
|
|
|
|
|
GEORGE CASSIEL
Um blog sobre literatura, autores, ideias e criação.
_________________
"Este era un cuco que traballou durante trinta anos nun reloxo. Cando lle
chegou a hora da xubilación, o cuco regresou ao bosque de onde partira.
Farto de cantar as horas, as medias e os cuartos, no bosque unicamente
cantaba unha vez ao ano: a primavera en punto."
Carlos López, Minimaladas (Premio Merlín 2007)
«Dedico estas histórias aos camponeses que não abandonaram a terra, para encher os nossos olhos de flores na primavera»
Tonino Guerra, Livro das Igrejas Abandonadas |
| |
|
|